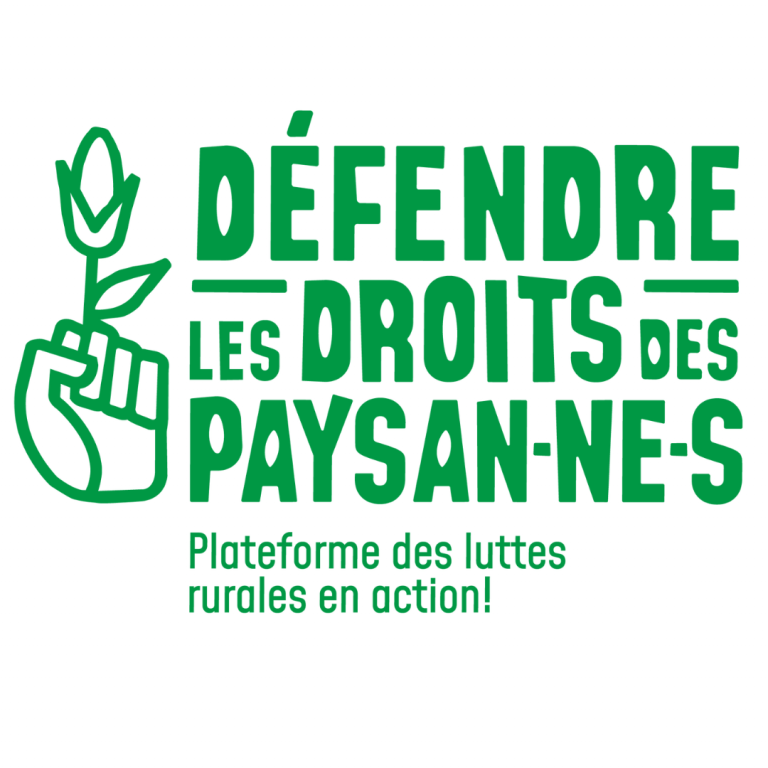La mécanique d’Al Omran

D’Al Omran au Développement
Lorsque des humains se rassemblent sur un territoire donné et coopèrent économiquement, ils génèrent une dynamique de prospérité collective qui se traduit par al ômran. Cette dynamique constitue la base du système collectif de subsistance, un ensemble de fonctions pour optimiser le partage de ressources, l’échange, la coopération et ainsi augmenter la résilience du groupe et son ancrage, continu ou momentané, au territoire.
Bien que ce terme soit traduit en français par « civilisation » et parfois par « urbanisme », il se rapproche plus, dans la pensée d’Ibn Khaldoun, du système de développement socioéconomique collectif qu’un groupe met en place organiquement pour vivre, produire et échanger. Ibn Khaldoun différencie d’ailleurs deux types de ômran : urbain حضري( ) et bédouin (بدوي) dont la principale caractéristique est le
nomadisme. La sédentarité n’est donc pas une condition du ômran tel que pourraient le suggérer les substantifs de la racine arabe du mot, ayant aussi donné naissance aux termes : عمارةbâtiment, معمار architecture, تعميرurbanisme. Al ômran est d’abord la rencontre et la coopération, s’il est nomade, il tend à se sédentariser, mais sa condition principale est la justiceالعدل أساس العمران.
Al ômran, ce qui « développe » le pays, améliore sa condition à travers l’agriculture,
la manufacture, le commerce, le peuplement, la prospérité et la citadinité.
Pour les architectes tunisiens d’aujourd’hui, comme pour les économistes, les sociologues, les ethnologues ou les géographes, le concept intraduisible d’al ômran apporte des clés essentielles à la compréhension de l’essence du développement humain et territorial. En observant son Maghreb natal et en décrivant la vie de ses concitoyens, Ibn Khaldoun a touché du doigt la mécanique socioéconomique qui l’anime, réussissant ainsi, du même coup, à déterminer les conditions de base de toute prospérité collective.
Dans son état bédouin comme citadin, al ômran nait de l’économie de subsistance. Au début le mot d’ordre est à la modération, à l’autosuffisance et à la parcimonie. L’agriculture, la manufacture et le commerce sont les activités économiques naturelles, auxquelles s’ajoute la fonction publique – ou la gouvernance – الإمارة, lorsque l’Etat se développe et commence à assurer des services publics (sécurité,
administration…). Ces activités génèrent المعاش -ou moyen de gagner sa vie-pour la population.
L’auteur distingue deux niveaux de revenus : en premier lieu, le revenu de subsistance الرزق, il est tiré du travail et sa valeur correspond au minimum vital décent. Ensuite le profit –légitime –الكسب qui est la plus-value, dégagée aussi du travail, mais dont la valeur augmente proportionnellement à l’intérêt et à l’utilité de l’activité pour la communauté. Cette distinction est très importante car elle fixe une sorte de limite basse à la valeur du travail. Si le premier permet la subsistance, le deuxième peut évoluer jusqu’à permettre le confort رغد, voire même le luxe الترف. Il faut noter que dans la pensée d’Ibn Khaldoun, la rente الريع et le monopole sont considérés comme nocifs, car ils génèrent des bénéfices sans travail.
L’activité économique qui rétribue justement le travail appelle au peuplement. A partir de là, la vie communautaire se développe, les revenus, le profit et les échanges aussi, la consommation augmente et provoque l’évolution des techniques, des arts et de l’innovation. Al ômran prend sa couleur culturelle الصبغة, l’architecture lui donne corps et l’administration âme. Il s’agit d’une mécanique socioéconomique presque organique, alimentée par le travail et poussée par la coopération vers la prospérité
commune.
En ce qui concerne l’architecture, l’auteur distingue deux types : la construction pour le commun العامّة et la construction pour l’élite الخاصة. La première, sur laquelle il s’attarde en décrivant le métier d’architecte, s’adresse à la masse, elle se fait à de petites échelles, par la densification ou l’étalement عمارة الأحواز, avec des matériaux disponibles et différentes techniques maîtrisées par la population. Le rôle de l’architecte est d’accompagner l’auto-construction, de solutionner les problèmes des habitations, d’organiser les lieux de travail, de codifier la gestion et l’utilisation de l’espace public, etc. mais aussi de réfléchir sur les politiques de « peuplement » إعمار.
Son métier s’adresse aux citoyens et sa responsabilité est de suivre l’évolution organique en apportant son expertise et son sens de la justice et du commun. La seconde, la construction pour l’élite, marque souvent les moments de changement de régime ou d’expression de l’autorité et fait intervenir des architectes et des artisans étrangers pour réaliser des ouvrages ou des édifices symboliques, marqués
d’une certaine extravagance.3
C’est en cherchant vainement la traduction d’al ômran en d’autres langues, que l’on prend conscience de l’étendue du concept et de son opposition au concept récent de développement. Al ômran prend une dimension politique particulièrement intéressante chez Ibn Khaldoun ; celle-ci interpelle par sa modernité. Voici quelques éléments saillants de la posture khaldounienne sur le sujet :
– Al ômran est un fait « sociétal », il est le résultat de la coopération entre les individus التعاون, le désir de prospérité partagée en est le moteur ;
– L’impulsion initiale d’al ômran répond au besoin commun de subsistance et vise l’autosuffisance en premier lieu ;
– Al ômran croit grâce au travail et à l’échange, la notion de justice constituant la base des rapports sociaux de coopération ;
– Les arts, les savoir-faire, l’architecture, l’administration, expriment l’essor du ômran, aux sens économique, social, politique et culturel.
Il faut rappeler qu’Ibn Khaldoun est philosophe, historien, juge et homme politique du XIVème siècle, né à Tunis à l’aube de l’ère de déclin du Maghreb. Il a exercé des fonctions politiques dans plusieurs capitales de l’époque3, sous différentes allégeances et vécu dans des milieux très différents4. Il a ainsi pu observer et analyser différentes dynamiques de peuplement dans la région, certaines en déclins, d’autres en essor. Toute sa vie, il a travaillé sur un ouvrage intitulé Kitab Al Ibar – le livre des leçons – dont la problématique essentielle était « comment naissent, croissent et meurent les civilisations ? », l’introduction « Les Prolégomènes » en est la quintessence. En se concentrant sur les contextes, il a pu mettre en évidence le rapport étroit entre environnement, société, économie et politique. La sociologie est née avec lui, transformant l’histoire de récits de faits plus ou moins réels, en analyses de structures et de conjonctures. Le concept d’al ômran lui a été très utile pour rendre compte des mécanismes à l’œuvre derrière l’essor ou le dépérissement des civilisations. Ibn Khaldoun se place à un moment clé de notre Histoire, celui où nous entrons en récession. Car, malheureusement pour nous, l’ère de déclin inaugurée au XIVe
siècle n’est toujours pas arrivée à son terme, notre région n’a pas connu de dynamique de prospérité souveraine depuis. Tombée sous la domination ottomane au XIVe siècle, elle s’en émancipe à peine au XIXe, pour tomber sous la domination européenne, alors en pleine expansion industrielle. Après leurs indépendances, les Etats de la région ont suivi un par un les voies du développementتنمية, un concept qui
a permis d’assigner leurs économies au service de l’économie globalisée et dont l’opposition à celui de Omran est remarquable, ainsi que nous le verrons plus tard.
C’est dans les années cinquante, avec les mouvements de libération nationale, que naissent les thèses développementalistes. Au départ, elles expriment le désir des peuples colonisés d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance économique et leur volonté de construire des économies nationales productives leur permettant de rattraper le retard historique. Mais les séquelles économiques, sociales, culturelles et environnementales du colonialisme européen sont lourdes et profondes, car l’occupation du territoire s’est accompagnée d’une modification radicale des structures sociales et des systèmes économiques, transformant ainsi les modèles de production et d’échange locaux en les assignant à des tâches dans un système globalisé. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les thèses développementalistes deviennent des outils de traitement du « sous-développement » par les Nations
Unies et les institutions financières internationales, à l’intention des pays arriérés nouvellement indépendants. Or, cette prise en main du développement du monde par les puissances économiques mondiales n’est pas dénuée d’idéologie. Les modèles appliqués aux pays sous-développés sont axés sur la modernisation, l’industrialisation, la croissance –et, plus tard, la mondialisation- et conçus pour
pérenniser les rapports de domination économique. Depuis, nous pouvons dire que le terme « développement » تنمية a remplacé dans notre lexique celui d’al ômran pour désigner cette dynamique économique idéale, censée apporter la prospérité pour tous.
L’opposition sous-jacente
Dès le départ, la notion de développement accepte le fait que la dynamique économique positive recherchée puisse être insufflée de l’extérieur. Ce paradigme s’est ancré à tel point qu’aujourd’hui, le développement est indissociable de la dette. Là où al ômran est un fait sociétal qui résulte de la coopération entre individus, le développement est un fait institutionnel qui résulte de l’investissement financier. L’Etat, les institutions financières, l’ONU et les banques en sont ses principaux acteurs. La notion de coopération est entendue dans le développement entre Etats, Etats et institutions, -les pays riches sont sensés aider les pays sous-développés -, alors qu’al ômran l’envisage sous l’angle de l’entre-aide entre individus et groupes d’individus au sein d’une société. Dès le départ aussi, le concept de développement est façonné pour s’insérer dans le modèle libéral de Bretton Woods. Le développement économique est associé à la croissance, aux échanges commerciaux et la valeur ajoutée monnayable sur le marché mondial. Le développement est l’entrée dans la modernité occidentale et l’intégration dans le libre-échange. Contrairement au ômran qui nait de la dynamique d’autosuffisance et d’économie de subsistance, le développement naît de l’économie5 de profit. Il a évolué ensuite et connu des déclinaisons en fonction des rapports de forces (développement social, humain, durable), mais il reste dans son essence fondé sur la recherche du profit et n’accorde que marginalement d’importance à la
subsistance de l’humain ou l’économie des ressources. Cela explique pourquoi la notion de développement a tant de mal à constater et mesurer l’injustice. En effet, de grands efforts sont déployés par les agences et les institutions pour améliorer la mesure du développement et la rapprocher de la réalité socio-économique des communautés. Au début, le développement est mesuré par le
niveau de vie (PIB/Habitant). Dans les années 90, le PNUD invente l’Indice de Développement Humain qui « intègre le caractère multidimensionnel du développement », en 1995 on introduit la « dimension genre » avec l’indice sexo-spécifique ISDH et l’Indice de Participation des Femmes IPF, à partir de 1997 on
commence à mesurer la pauvreté à la fois dans les pays développés et sous-développés avec l’Indice de Pauvreté Humaine IPH… Aujourd’hui, toute une batterie d’indicateurs est employée par l’ONU5 pour mesurer la misère humaine. L’attitude de la communauté internationale face à l’injustice économique provoquée par des modèles de développement défaillants, est de traiter les impacts les plus
spectaculairement injustes. Alors que le développement traite marginalement les injustices les plus graves, al ômran place la justice à la base de toute dynamique de prospérité collective. Ibn
Khaldoun va jusqu’à décrire les mécanismes d’injustice économique responsables de la destruction progressive d’al ômran et à affirmer que la multiplication des injustices est annonciatrice de décadence. De ces mécanismes, il cite explicitement :
– L’accaparement et le monopole وضع الضياع في أيدي الخاصة، الاحتكار
– L’impôt injuste بذرائع باطلة يتوسَّ ل بها؛ كالمكوس)الضَّ رائب(المحرَّ مة والوظائف الباطلة
– L’assignation de la population à un travail contraint تكْليف الأعمال وتسخير الرعايا بها؛
حيث ُ يغتصبون قيمة عملهم
– La dépossessionالتَّ سلُّ ط على النَّ اس في شراء ما بأيديهم بأبْخس الأثمان
Ayant derrière nous quelques siècles de décadence, nous ne pouvons que lui donner
raison de ses analyses et confirmer, par le diagnostic de notre situation actuelle, le
bien fondé de ses observations. Notre système économique est oligarchique, rentier
et dépendant, il s’alimente par un système fiscal injuste, il est assigné par le libre-échange à des tâches de bas de gamme et réduit la valeur du travail à un niveau très bas. Notre modèle de développement est foncièrement anti-ômran.
Nous avons expliqué plus haut qu’al ômran se construit sur la capacité du tissu économique à garantir un revenu minimal par le travail, الرزق, ainsi que sa capacité à permettre le profit légitime الكسب, par le travail aussi. Dans la mesure où la libre circulation était un droit, lorsque le revenu minimal ne permettait plus
une vie descente المعاش, on changeait d’endroit6. Dans cette vision, la prospérité se mesure alors d’abord au niveau de vie des communs, particulièrement les moins bien lotis. On ne peut pas parler de prospérité collective lorsque le pain quotidien n’est pas garanti pour tous. La mécanique de la prospérité démarre donc par le bas, par la satisfaction des besoins vitaux et se propage horizontalement à la recherche de
l’équilibre de معاش pour tous. Et c’est ce qui est considéré comme besoin vital qui est sensé évoluer avec l’évolution du ômran. Au départ, il s’agit simplement de se nourrir et de s’abriter, une fois ces deux conditions satisfaites, on cherche à se stabiliser, à sortir de la précarité. A ce moment, le besoin vital n’est plus de se nourrir aujourd’hui, mais de se nourrir toute l’année, il n’est plus de s’abriter cette saison, mais de s’abriter toute la vie. Lorsque le besoin vital est ainsi redéfini, on note une nette évolution du ômran, du nomade vers le sédentaire, ou encore du communautariste vers le civilisationnel. On peut penser être, au XXIème siècle, bien loin de ces considérations moyenâgeuses, mais on fait vite de constater ce que l’on conçoit aujourd’hui comme besoin vital n’est pas du tout acquis pour la population de notre pays. On peut se référer ici aux droits fondamentaux énoncés dans la constitution tunisienne :
alimentation, accès à l’eau, santé, éducation, auxquels on doit ajouter le logement7.
D’autant plus que le droit à la libre circulation, permettant de réguler la densité humaine en fonction de la prospérité, est aujourd’hui, de fait, non reconnu, voire même criminalisé. Et même si notre jeunesse est plus éduquée aujourd’hui qu’il y a un siècle, son émigration massive, officielle ou clandestine, nous rappelle que nous sommes bien encore dans une phase historique de déclin.
Les thèses contemporaines auxquelles s’adossent les théories de développement soutiennent que, pour donner un coup de pouce à la prospérité de la population, il faut investir dans de grands équipements économiques et techniques : la politique des mégaprojets. Pour certains, l’Etat doit le faire, pour d’autre, il s’agit du marché légitime des entreprises privées. Les moyens, quant à eux, sont sous-entendus
empruntés dans les deux cas. Cette approche fait que, quelle que soit la vision (socialiste ou libérale), on sélectionne en haut lieu un ensemble de gigantesques infrastructures considérées prioritaires et que l’on y place le plus gros de sa capacité d’investissement et d’encouragement à l’investissement. La plus-value dégagée de la réalisation de mégaprojets est sensée compenser l’investissement et générer une
rentabilité économique et sociale, assimilée à de la prospérité partagée.
Or, le plus souvent, le fait institutionnel qu’est le développement ainsi créé est complètement déconnecté de son contexte, sa relation avec le territoire se résume au retour sur investissement, il ne génère pas de dynamique territoriale de prospérité durable. Car la logique de profit à l’origine du développement oriente les investissements géographiquement et par secteur vers les niches les plus rentables
financièrement (immobilier haut standing, finance, télécommunication, commerce mondialisé, services marchands…) et non pas vers la dynamisation des activités naturelles (agriculture, métiers et manufacture, commerce local). Dans sa globalité, la dynamique tend à maximiser le profit pour l’élite et à limiter à son minimum le revenu de subsistance pour la masse. Dans cette configuration, le travail des uns
augmente les profits des autres et l’enrichissement se fait par la rente, le monopole et l’exploitation bon marché des ressources, notamment humaines. Le travail est de fait dévalorisé économiquement et socialement.
Dans ce modèle, tant que les profits augmentent, on considère qu’il y a croissance et que le territoire est en développement, alors même que certaines régions choisies sont sous perfusion, que l’activité économique ne garantit pas le pain quotidien et que le clivage entre élite الخاصة et commun العامة s’approfondit, l’injustice devient alors l’autre facette du développement. Ironiquement, même lorsque la prospérité dégagée de l’investissement est minime ou même négative pour la population et extrêmement
lucrative pour certains, l’infrastructure réalisée est tout de même considérée comme une manifestation de développement.
Le cas de la Tunisie illustre parfaitement l’échec de ce modèle dans ses versions moderniste (Kheireddine), socialiste (Ben Salah) et oligarchique-libérale (à partir de Nouira), pourtant, les mêmes politiques continuent d’être appliquées aujourd’hui. Ne présente-t-on pas, en guise de projets de développement, des villes nouvelles sur des terrains vagues ? Des ports et des aéroports fantômes dans des régions
dévastées par la pauvreté (Tabarka, Enfidha…) ? Il s’agit d’un urbanisme artificiel pour des dynamiques artificielles qui ne se connectent en rien à la réalité du commun et qui ne répondent en rien à ses besoins. Le développement est ici plus un appareil d’accumulation de richesse pour l’élite qu’une dynamique de prospérité pour la masse.
L’ômran étant un fait sociétal guidé par le besoin commun de subsistance, le travail et l’échange sont valorisés à l’échelle communautaire car tous les protagonistes bénéficiant d’al ômran sont reliés par l’intérêt commun et coopèrent pour cet objectif. Une telle condition impose une sorte de contrat moral sur la valeur du travail et celle des produits échangés. Celles-ci sont définies en fonction de l’utilité pour la
communauté et de la disponibilité des différentes ressources nécessaires à la production. Les prix sont définis d’abord par rapport aux coûts et aux besoins locaux, la surproduction est valorisée après autosuffisance. La notion de justice, si chère à Ibn Khaldoun est la clé de voûte d’une dynamique économique saine. Pour lui, la chose est simple, la justice est la base sur laquelle se construit al ômran. Lorsque les rapports de production sont injustes, on peut parler de développement, mais on ne
peut certainement pas parler d’ômran.
Renouer avec al Omran ?
D’éminentes voix se sont levées en Occident contre le concept de développement, notamment depuis que la question de la finitude des ressources à définitivement bloqué la perspective d’une croissance indéfinie. On admet aujourd’hui que le développement, mesuré par la croissance, ne peut être sans fin. Deux visions se sont alors développées dans le monde occidental : le développement durable et la
décroissance. Le premier est aujourd’hui le slogan des institutions financières et des agences de coopération internationale, mais l’adjectif le plus employé par la société civile critique à son égard est le « green-whashing » : la coloration en vert écologique de politiques de développement foncièrement injustes et non durables. La décroissance, elle, demande aux pays les plus développés d’engager une
décélération de leur économies, en changent de mode de vie et en réduisant leur dépendance aux ressources fossiles. Il est difficile d’imaginer les gouvernements occidentaux annoncer la décroissance aux multinationales, en revanche, un marché de l’écologie est une opportunité prometteuse… Aujourd’hui, au nom du développement durable, on peut acheter et vendre des bons-pollution et spéculer sur
le prix de l’eau partout dans le monde.
En Tunisie, le sentiment d’injustice atteint son paroxysme quand il s’agit précisément de développementالتنمية. Depuis 2010, le nombre de mobilisations et de mouvements sociaux dénonçant la marginalisation et revendiquant le développement se compte en centaines par année. Cette demande provient de régions entières (Sud, Ouest, centre, Nord-Ouest), et de la plupart des délégations des autres régions. La demande est d’autant plus insistante qu’elle est portée par les principaux groupes
sociaux ensemble : les paysans, les travailleurs de l’informel, les salariés, les petites entreprises, bref, tous ceux engagés dans l’économie naturelle, et bien évidemment, ceux qui en sont écartés : les chômeuses et les chômeurs…
La réponse des gouvernements successifs cadre parfaitement avec le « développement durable », par exemple, de l’emploi précaire dans la sous-traitance à l’Etat pour les travaux –fictifs- de plantation et de protection de l’environnement. Des milliers de contrats sont ainsi distribués aux contestataires pour acheter leur silence. D’autres projets sont promis telles que des infrastructures, des équipements,
des sites extractivistes, des zones industrielles… Tous répondant au même modèle de développement : modernisation, industrialisation, croissance et importation-exportation et tous en complète déconnexion avec les principes d’une dynamique socio-économique saine et tous financés par la dette.
Pourtant, nous pouvons dire que la génération « développement » est arrivée implicitement à la conclusion que les modèles économiques mis en place dans les pays du tiers monde sont injustes et insoutenables. Et bien que le terme « développement » continue à être employé pour désigner l’aspiration populaire à une prospérité collective, le concept lui-même est incapable de transcrire le désir
profond de rupture avec les modèles développementalistes. Les thèses occidentales nouvelles ne nous sont malheureusement d’aucune aide, car celle du développement durable se heurte aux contradictions du concept de développement lui-même et celle de la décroissance ne peut décrire la revendication collective légitime d’une prospérité commune.
Face à cette impasse, le renouvellement du concept d’al Omran nous ouvre la voie vers une alternative que l’on pourrait qualifier d’organique dans sa façon de considérer l’environnement, la société et l’économie comme un écosystème à la fois naturel et artificiel, animé par une dynamique humaine fondée sur les principes de souveraineté, de coopération et de justice et de valorisation du travail et maintenue
par le désir collectif de prospérité.
Dans une vision« ômraniste », les forces vives seraient dirigées, par l’intérêt commun à la prospérité collective, vers la recherche de plusieurs équilibres fondamentaux interdépendants et situés à différentes échelles, par exemple :
– L’équilibre entre la valeur du travail et le coût d’une vie décente ;
– L’équilibre entre la production locale et les besoins de consommation locaux ;
– L’équilibre des poids démographiques et économiques des agglomérations
par rapport à l’écosystème qui les accueille et les alimente en ressources
naturelles ;
– L’équilibre au sein de l’économie naturelle -agriculture vivrière, industrie
locale, commerce local et frontalier- dans un système primaire orienté vers
l’autosuffisance ;
– L’équilibre entre les masses sociales et la représentativité dans le système
politique
– L’équilibre entre la capacité de production du pays et ses échanges extérieurs
Le rôle de l’Etat dans la fluidification de la mécanique du ômran est important, notamment parce qu’il emploie la masse sociale la mieux organisée et la plus lourde,démographiquement et économiquement. De plus, il constitue l’appareil de gouvernance et de gestion de la vie publique, dispose du budget collectif et assure la gestion des ressources et des biens publics. Il a également la capacité de lubrifier la
mécanique en libérant de la liquidité et en augmentant la valeur du travail.
Sur ce dernier point, il faut rappeler qu’en donnant une valeur décente au travail, on renforce l’économie réelle fondée sur les activités naturelles, on augmente les revenus moyens, on dynamise l’écosystème économique local et on renforce les mécanismes de redistribution (couverture sociale, fiscalité, services publics…). Aussi faut-il souligner que tant que le travail est dévalorisé, l’économie ne sera pas productive, la dynamique qui l’anime tendra toujours vers la rente et la spéculation, il s’agit donc d’un levier essentiel au changement de modèle.
En se plaçant dans une perspective ômraniste, la mesure de la prospérité collective devra se faire relativement au niveau de vie des catégories sociales les plus basses et l’investissement public s’orienter vers l’amélioration des conditions de vie du commun. Autrement-dit, on ne ciblerait plus les grandes infrastructures intégrées dans l’économie mondiale ou les projets immobiliers pour l’élite, mais les
équipements les plus simples et les moins coûteux, on s’orienterait d’avantage vers le logement social, l’aide à l’auto-construction et l’accompagnement des communautés, ainsi que vers la réhabilitation de l’existant, l’adaptation aux enjeux climatiques et la reconversion des constructions vétustes. A cette échelle, l’investissement est dérisoire, la gestion plus aisée et la rentabilisation plus rapide.
On initie ainsi des dynamiques locales qui répondent à des besoins vitaux et agissent directement sur la prospérité commune. D’autant plus qu’il s’agit de dynamiques qui créent de l’emploi, améliorent les techniques et les savoir-faire et soutiennent le marché local.
Notre intérêt collectif se situe aujourd’hui dans le ré-déclenchement de la mécanique organique du ômran. Ceci passe, entre autre, par l’assainissement de notre système économique de la rente et de la spéculation, l’établissement d’une justice fiscale, la garantie d’un revenu minimal décent, la mise à la disposition des groupes productifs des ressources disponibles -dans le respect des équilibres environnementaux, sociaux et économiques-, la coopération interne, la valorisation du travail et le
recouvrement de la souveraineté. Ces leviers essentiels au ômran sont maintenus en état de blocage par l’idéologie prônant le développement. Pour les libérer, la société civile dans son ensemble (mouvements, associations, syndicats, universitaires, journalistes…), adossée aux groupes sociaux concernés par ce changement de cap en matière de politiques publiques (paysans, artisans, salariés, entrepreneurs, chômeurs…) a un rôle déterminant à jouer : elle devra bâtir des bases conceptuelles nouvelles pour un modèle socio-économique innovant adapté à la Tunisie du XXIème siècle. Il s’agira de rompre avec la philosophie libérale du développement globalisé, de renouer avec les principes basiques du ômran et de tracer l’esquisse d’un modèle socio-économique nouveau, alternatif, dont l’objectif premier est de tendre vers les équilibres fondamentaux précédemment cités.
Vous trouverez plus d’informations sur l’urbanisme dans le 4e numéro de Lendemains solidaires
3 Tunis, Tlemcen, Grenade, Bejaïa, Fès, Marrakech, Le Caire, Damas…
4 Palais, prisons, campement de tribus, champs de batailles, grottes…
5 Wikipedia.org. Objectifs du millénaire : Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim ; Réduire de trois quarts la mortalité maternelle ; Assurer l’éducation primaire pour tous ; Combattre les maladies, en particulier le VIH/sida et le paludisme ; Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; Assurer un environnement durable ; Réduire de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
6 Cette analyse ne tient pas compte de l’esclavage
7 Bien qu’omis de la liste, ce droit constitue la base même des autres droits fondamentaux.