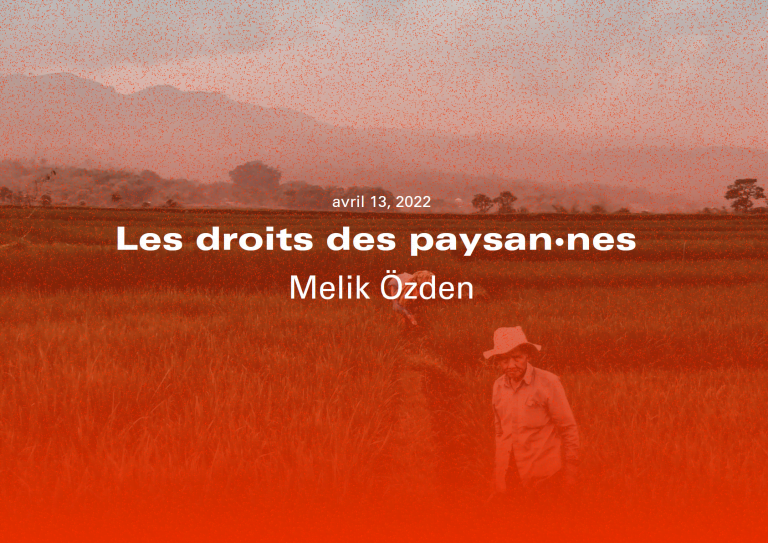EDITORIAL

Par Melik Özden, Directeur du CETIM
Si l’environnement influe sur les modes de vie, l’inverse est aussi vrai. En effet, toute intervention sur l’environnement (construction d’infrastructures, transports, production alimentaire ou industrielle) a des impacts, positifs ou négatifs, sur les êtres vivants. De nos jours, le système économique dominant, basé sur la croissance infinie et le profit à tout prix, met à mal l’environnement avec une exploitation effrénée des ressources naturelles non renouvelables.
Depuis quelques décennies, plusieurs mouvements écologistes ont vu le jour. En parallèle, nombre de mouvements sociaux ont intégré dans leurs agendas la défense de l’environnement, soit de manière générale, soit de manière sectorielle (biodiversité, espèces menacées, cours d’eau, etc.).
Historiquement victimes d’oppressions multiples, les femmes ont été doublement affectées par ce système prédateur, en particulier dans les pays du Sud. Les femmes, autochtones et rurales en particulier, sont souvent les premières victimes des crises environnementales. Ainsi, le mouvement pour la justice environnementale et le mouvement féministe ont entretenu des interactions profondes et significatives. Ce dernier1 souligne que l’oppression des femmes et la marchandisation de la nature sont intrinsèquement liées, car elles sont toutes deux le résultat d’un même système de domination patriarcal et capitaliste.
Le présent numéro de Lendemains solidaires est consacré aux interactions entre ces mouvements. Les inégalités et la marchandisation de la nature ont poussé les femmes à s’organiser pour lutter non seulement pour leurs droits, mais aussi pour revendiquer la souveraineté populaire sur les politiques environnementales, alimentaires et de développement. Le fait que ces dernières soient en première ligne des luttes contre l’accaparement des terres et l’extractivisme par les multinationales, les expose à des répressions violentes.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les analyses et les expériences de luttes de plusieurs mouvements sociaux de différents continents, engagés dans les luttes pour la justice environnementale, mais également contre les inégalités de genre et de classe, contre l’impunité des sociétés transnationales et pour la souveraineté alimentaire. C’est dire que leur lutte contre la crise environnementale ne se limite pas au seul calcul d’émissions de carbone. Cette vision globale leur permet d’envisager des solutions aux problèmes environnementaux avec une réflexion sur les structures de pouvoir et les dynamiques sociales qui perpétuent les inégalités.
En ce sens, ces mouvements convergent dans leur appel à une transformation systémique qui reconnaît l’interdépendance entre les droits humains, en particulier les droits des femmes, et la protection des écosystèmes. Ces mouvements doivent être soutenus contre les tentatives de criminalisation, et surtout pour la justesse de leur combat.
1Nous entendons par « mouvement féministe », les mouvements qui prônent un changement de société qui inclut la justice sociale et environnementale, en opposition au « féminisme libéral ».