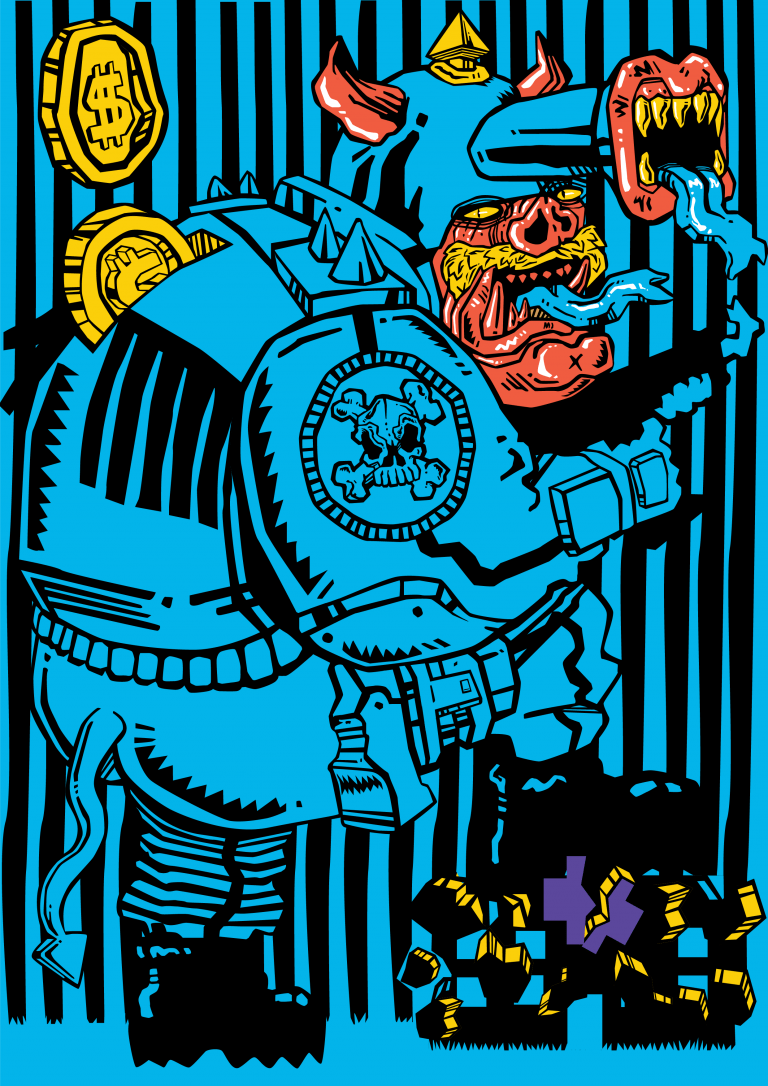COLOMBIE : LES FEMMES DE TABACO CONTRE GLENCORE

Entretien avec Inès Pérez Arragoces, dirigeante afrodescendante colombienne, militante contre l’action de Glencore à la Guajira
La communauté de Tabaco, située dans la région de la Guajira en Colombie, était, avant son déplacement forcé, une communauté paysanne afro-colombienne profondément enracinée dans son territoire. Elle se reconnaissait comme une entité autonome, dotée d’une forte cohésion sociale, nourrie par des pratiques agricoles, culturelles et spirituelles transmises de génération en génération. Ce lien au sol, à la terre et à l’eau façonnait un mode de vie agroécologique et communautaire. Les habitant·es vivaient essentiellement de la culture du maïs, du manioc, des légumes, de la pêche dans les rivières, et de l’élevage. Cette économie de subsistance n’était pas seulement un moyen de survivre : elle structurait une manière d’habiter le monde, fondée sur la solidarité, le partage et le respect du vivant.
La communauté est une culture afro-colombienne vivante, pleinement assumée, inscrite dans les gestes du quotidien comme dans les temps festifs. La musique et la danse y occupaient une place centrale. Tambours, guacharaca et vallenato rythmaient les rassemblements, porteurs d’une mémoire collective enracinée dans les luttes et les célébrations. La transmission culturelle passait aussi par la cuisine, notamment lors de la Semaine Sainte, où l’on préparait des plats traditionnels comme le chiquichiqui, la cachapa ou les arepas, à base de maïs et de produits naturels. Ces savoir-faire, ancrés dans le territoire et dans l’histoire des femmes. À travers ces pratiques, la communauté affirmait son identité de peuple noir, revendiquant une reconnaissance aussi bien interne qu’externe : « nous nous identifions comme Noirs, et les autres nous identifiaient ainsi ».
À travers ces pratiques, la communauté affirmait son identité de peuple noir, revendiquant une reconnaissance aussi bien interne qu’externe : « nous nous identifions comme Noirs, et les autres nous identifiaient ainsi
Mais cette culture n’a jamais été figée. Elle s’inscrit dans une longue histoire de résistance pour la défense du territoire. La mémoire collective évoque les conflits passés, les luttes des ancêtres pour préserver leurs terres face aux expropriations, bien avant l’arrivée des grandes entreprises minières. À l’époque, des villages comme Roche, Tamaquito, Patilla ou Manantial constituaient avec Tabaco un réseau de communautés noires solidaires, unies par leur héritage ancestral et leur combat commun pour la terre. Le déplacement forcé n’a pas effacé cette mémoire combattante.
Lendemains Solidaires : Dans le cadre de la lutte contre la mine de charbon de Glencore, comment concevez-vous l’articulation entre la lutte pour la réparation collective, la lutte féministe et la défense de l’environnement ?
Inès Pérez Arragoces : Eh bien, en tant qu’organisation de femmes engagées dans cette lutte, en tant que femmes, peut-être, on réfléchit et on ressent plus la lutte dans notre chair. On vit ça à partir de notre connexion à la nature.
Nous avons besoin de notre territoire. On a besoin d’un toit. On est conscientes des besoins de la communauté parce qu’on les vit tous les jours. On voit le territoire d’un autre œil. Nous, les femmes, on donne la vie, et la Terre-Mère, on la considère aussi comme une femme : elle donne la vie, elle aussi.
Donc on comprend que les besoins de la communauté sont liés à cette lutte. Ce n’est pas abstrait, c’est le quotidien. Et nous, on se bat comme on s’accroche à la terre. On est plus conscientes de ce qu’on vit et c’est ce qui est nécessaire pour continuer à lutter.
Les femmes, on ne se limite pas à notre propre foyer, aux enfants, aux maris. On est aussi en première ligne dans la recherche de solutions pour toute la communauté. Face aux crimes de cette entreprise et aux assassinats qui ont lieu dans notre territoire, les autorités n’agissent pas. Pire, elles s’en rendent aussi complices. Tout est organisé pour empêcher qu’on enquête et ceux qui devraient enquêter sont achetés pour se taire.
LS : Et les hommes dans tout ça ?
IPA : Les hommes, eux, sont souvent plus facilement tentés par l’argent des entreprises. Nous, les femmes, on résiste. On est moins corruptibles. On travaille le ventre vide, mais on préfère nourrir nos enfants plutôt que de nous vendre. C’est là que commence notre vraie résistance.
Dans la communauté de Tabaco, nous avons formé un front de femmes. Il existe aussi une organisation non enregistrée que nous avons appelée Féminas Nómadas. Grâce à elle, nous avons pu nous affirmer face aux hommes et nous organiser entre femmes.
Les hommes, eux, sont souvent plus facilement tentés par l’argent des entreprises. Nous, les femmes, on résiste. On est moins corruptibles. On travaille le ventre vide, mais on préfère nourrir nos enfants plutôt que de nous vendre. C’est là que commence notre vraie résistance
LS : Pourquoi vous vous êtes mobilisées et quels ont été les freins ?
IPA : Dès le début de la lutte, on a constaté qu’il y avait beaucoup de corruption, y compris parmi ceux qui se disaient leaders des communautés locales, certains avant moi, d’autres après. Cette corruption a freiné nos avancées. Nous avons alors sollicité des organisations nationales. Certaines sont venues, promettant un soutien juridique, des actions devant la Commission interaméricaine, des plaintes contre Glencore. Mais, une fois les promesses faites, elles sont reparties. Elles nous ont laissées seules.
Et pourtant, on avait cru en elles parce que c’étaient des femmes, comme nous. Mais quand les délais légaux pour faire valoir nos droits ont expiré, elles ont disparu. Alors, nous avons décidé de rompre avec toutes ces organisations et de reprendre la lutte entre femmes, par nos propres moyens.
LS : Et alors, depuis quand les voies légales ont semblé être bloquées ?
IPA : En 2017, nous avons intenté une action de tutelle (recours constitutionnel) contre Glencore, pour la relocalisation de notre communauté. On a mis notre argent en commun pour payer un avocat. Au début, la justice nous a déboutées. Mais ensuite, on a rassemblé plus de cent signatures d’organisations nationales et internationales. Grâce à ce soutien, on a pu porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle.
La Cour a finalement ordonné à Glencore de relocaliser la communauté et de respecter les accords signés en 2008. Elle a aussi mandaté les organes de contrôle : la Contraloría (audit public), la Procuraduría (bureau du Procureur) et la Defensoría del Pueblo (service du défenseur du peuple) pour encadrer le processus.
Ils avaient cinq mois pour reprendre les négociations et réviser les termes des accords, notamment les indemnités, qui étaient absurdes : parfois seulement deux millions de pesos, ce qui ne suffisait même pas pour acheter un terrain. Mais très vite, ces organes de contrôle, surtout la Procuraduría, ont commencé à jouer le jeu de l’entreprise. Un avocat a lancé une enquête. C’est là qu’on a découvert que les terres prévues pour la relocalisation n’étaient pas disponibles, que rien n’avait été concrètement préparé. Les accords n’avaient en réalité aucune validité juridique. Pendant que les hommes menaient les négociations, tout avait été corrompu.
LS : Comment avez-vous réagi ?
IPA : On a relancé un paro (blocage de la mine). Et cette fois, c’est nous, les femmes, qui étions en première ligne. Ce blocage visait à dénoncer l’immobilisme des tables de dialogue. Un représentant de l’entreprise est même venu nous dire : « Comment ça ? Des petites femmes vont bloquer une multinationale ? » Eh bien oui. L’une s’occupait de la cuisine, l’autre de la logistique, des courses… Chacune avait son rôle. Et grâce à cette mobilisation, les négociations ont repris.
Mais c’est aussi à ce moment-là que les menaces ont commencé. Des menaces contre nous, les femmes : des tentatives d’intimidation, des menaces de mort, parfois même d’assassinat. La version officielle prétend qu’il s’agit de groupes hors-la-loi, de paramilitaires ou de guérillas. Mais en réalité, ils agissent de concert et sont tous liés. Alors que nous nous retrouvons prises en étau.
Avant, on disait que les femmes de La Guajira n’étaient bonnes qu’à pleurer. Mais nous, on a décidé qu’on ne pleurerait plus. On allait affronter une multinationale, prendre des risques. Aujourd’hui, on est plus fortes que les hommes. C’est nous qui avons pris la mine. C’est nous qui sommes montées au front. Et ce sont eux, maintenant, qui restent en retrait.
Avant, on disait que les femmes de La Guajira n’étaient bonnes qu’ à pleurer. Mais nous, on a décidé qu’on ne pleurerait plus. On allait affronter une multinationale, prendre des risques.
UNE DÉLÉGATION COLOMBIENNE À L’ONU
Fin juin 2025, une délégation de Colombie (dont Inès Pérez Arragoces) est venue témoigner contre Glencore lors du Conseil des droits de l’homme et saisir les mécanismes onusiens de protection des droits humains avec la demande de :
- Surveiller étroitement et respecter le processus de relocalisation de la communauté de Tabaco, après son déplacement forcé en 2001 au profit de la mine Cerrejón, aujourd’hui exploitée par Glencore ;
- Exiger que cette relocalisation se fasse dans un territoire adapté, fertile, peu exposé aux risques naturels, doté de services publics essentiels, notamment en santé ;
- Veiller au respect des droits collectifs, en particulier le droit à la consultation préalable, à l’autodétermination, et aux usages culturels et coutumes de la communauté ;
- Appuyer la demande de réparation intégrale et d’une sanction exemplaire envers l’entreprise Glencore, en raison des violations reconnues par la Cour constitutionnelle de Colombie (arrêt T-329/2017) concernant les droits à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, au logement et au travail.