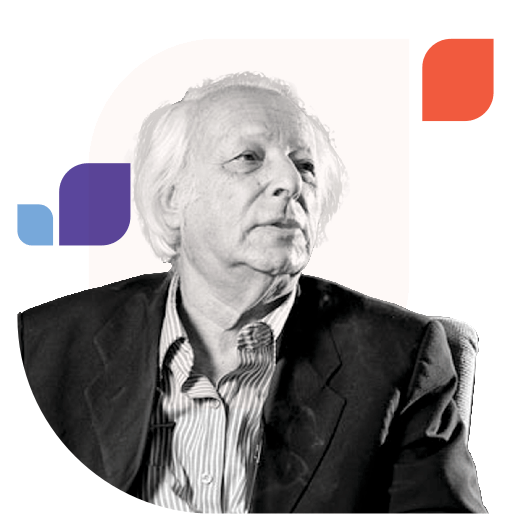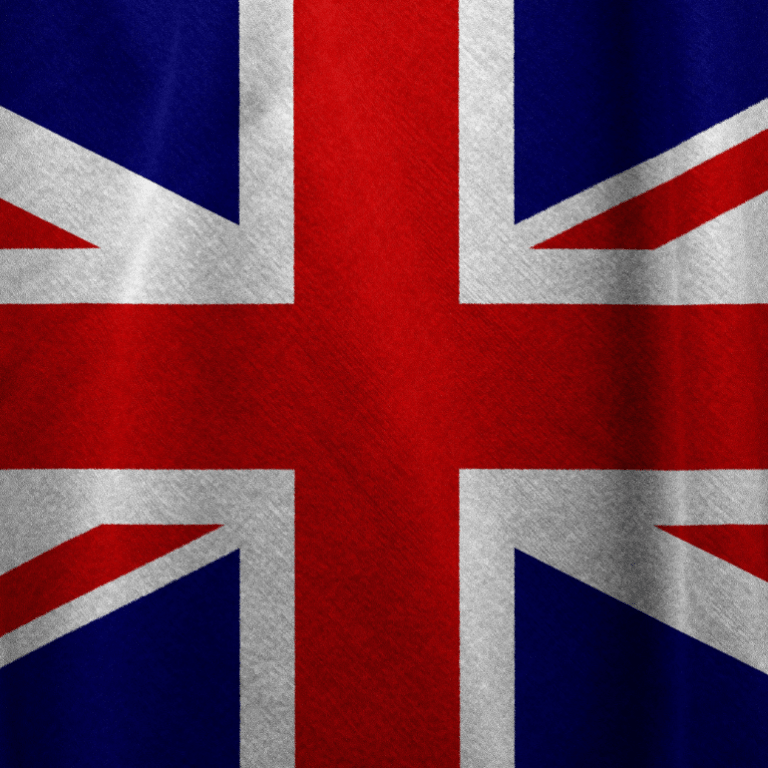LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : LEVIER POUR LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE

Interview de Joël Mützenberg, semencier genevois et membre d’UNITERRE
Face au modèle dominant de l’agrobusiness qui appauvrit les sols, pollue les eaux, uniformise les semences et détruit l’environnement, la revendication des communautés rurales pour la souveraineté alimentaire portée par La Via Campesina, dont UNITERRE – membre suisse de La Via Campesina – propose un véritable changement de paradigme.
Lendemains solidaires : En quoi la revendication de la souveraineté alimentaire portée par UNITERRE peut-elle constituer un levier concret en faveur de la justice environnementale ?
Joël Mützenberg – La revendication pour la souveraineté alimentaire est un changement de perspective par rapport aux revendications portées historiquement par les syndicats paysans. Il ne s’agit plus de défendre des intérêts spécifiques aux travailleur.euses de la terre. Il s’agit d’un projet d’émancipation qui redonne aux populations de chaque région du monde ‒ qu’elles soient rurales ou urbaines ‒ leur pouvoir de décision sur leur existence. Et non seulement la souveraineté alimentaire implique que la décision alimentaire soit relocalisée et donc reprise en main par les populations concernées, mais nous insistons aussi sur le fait que cette souveraineté ne doit pas s’exercer au détriment des populations d’autres régions. Il s’agit donc d’un projet global de justice sociale, qui refuse les logiques protectionnistes qui se feraient dans le seul intérêt des populations locales. La souveraineté alimentaire prend en compte l’intérêt des paysan.nes et des citadin.es, des pays du Nord comme du Sud.
LS : Comment UNITERRE, en tant que membre de La Via Campesina, agit-il pour faire avancer cet agenda à l’échelle internationale, et quels sont les principaux freins rencontrés ?
JM – UNITERRE est active à Berne (Suisse) au sein du « Groupe interparlementaire souveraineté alimentaire ». Mais nous sommes une organisation paysanne minoritaire, et de ce fait avons peu de moyens pour peser sur la politique institutionnelle. Cependant nous avons contribué au processus qui a mené à l’adoption en 2018 par les Nations Unies de la Déclaration sur les droits des paysan·nes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (DDP), déclaration qui vise l’adoption de politiques publiques en faveur de la souveraineté alimentaire. Nous agissons aujourd’hui au sein de la coalition des « Amis de la Déclaration » (Suisse), pour sa mise en œuvre dans nos politiques intérieures et extérieures.
LS : Pourquoi la défense des semences paysannes face aux logiques des semences industrielles est-elle centrale dans la vision d’UNITERRE sur la souveraineté alimentaire ?
JM – La souveraineté alimentaire implique une conception de la nourriture comme bien commun d’une population. Une population ne peut pas choisir son alimentation si elle dépend de la production de semences planifiée en d’autres lieux, ni si cette production est formatée par la grande distribution ou toute autre structure imposant ses intérêts au reste de la population.
Chaque semence est le produit d’un choix de sélections qui impliquent une manière de cultiver, une forme de distribution, des préférences culinaires etc. En fixant eux-mêmes leurs critères de sélection, les paysan.nes qui produisent leurs propres semences se donnent les moyens de faire leurs propres choix de pratiques agricoles. Si les paysan.nes sont dès le départ dépendants de choix qui leur échappent, comment le reste de la population pourrait-il avoir un quelconque pouvoir sur son alimentation ? Les semences paysannes impliquent une sélection décentralisée, et permettent ainsi une grande diversité, construite directement au contact des conditions naturelles de chaque région, diversité d’autant plus nécessaire dans une époque marquée par l’instabilité climatique.
Cette diversité permet aussi de coller aux choix de type de distribution, aux pratiques culinaires et à tous les aspects du système alimentaire qui aujourd’hui sont formatés par le complexe agro-industriel mondial.
LS : Et quelles sont les implications concrètes de cette lutte ?
JM – D’abord, il revient aux paysan.nes de s’organiser pour remettre en place des systèmes semenciers paysans. Ensuite, comme je l’ai évoqué, UNITERRE se mobilise pour une mise en œuvre de la DDP, dont l’article 19 traite justement de la défense des semences paysannes1. UNITERRE lutte également contre les OGM et les brevets sur les semences qui pourraient réduire à néant notre liberté de choisir collectivement la nourriture que nous produisons et que nous mangeons.
Finalement, le monopole de l’agro-industrie sur les semences n’est qu’un des aspects de la concentration de pouvoir qui s’opère dans le secteur agroalimentaire. A quoi servirait-il de défendre les semences paysannes si le marché est monopolisé par une poignée d’entreprises de distribution qui dictent leurs conditions ? Ou si la terre n’est plus détenue que par des entreprises agroalimentaires les après l’annexion de la dernière ferme paysanne ? La défense des semences paysannes ne peut faire sens que dans le cadre général d’une défense de l’agriculture paysanne et de la construction d’espaces de démocratie alimentaire. Les actions d’UNITERRE sur le thème de l’accès à la terre ou sur la mise en place d’une Assurance sociale de l’alimentation2 sont donc tout aussi nécessaires à la possibilité que notre alimentation soit issue de semences paysannes !
1Cf. www.cetim.ch/wp-content/uploads/Fiche-DDP_n%C2%B03-Semences-A4.pdf
2Cf. https://uniterre.ch/fr/vers-une-assurance-sociale-de-l-alimentation/