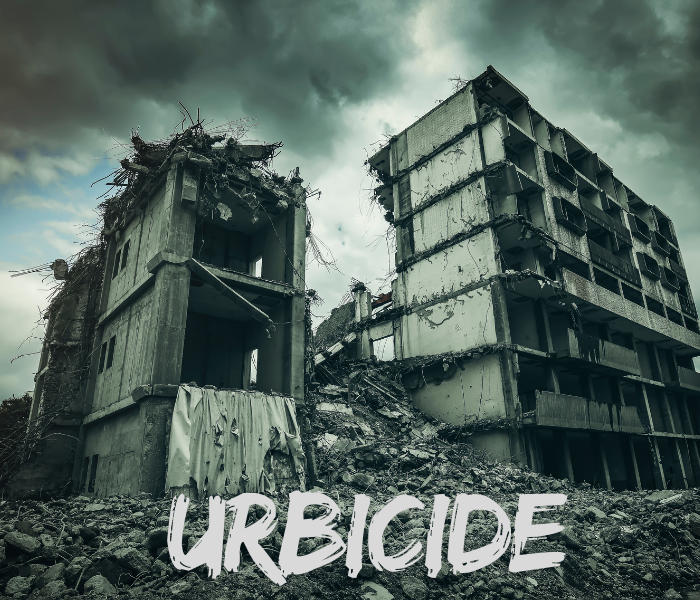Les guerres comme encadrement du Sud Global

Le darwinisme social1 belliciste est en train de devenir la norme fragilisant le système multilatéral dont la priorité était d’assurer une gouvernance globale pour maintenir la paix. Hélas, la paix ne représente plus une valeur commune pour de nombreux gouvernements tandis que la violence militaire devient toujours plus souvent le moyen privilégié pour maintenir les rapports de domination ainsi que pour l’aggravation du maldéveloppement.
Depuis la crise financière de 2008-2009, le monde occidental connaît la crise des inégalités sociales la plus drastique de l’histoire. Selon le rapport intitulé « Multinationales et inégalités multiples », publié par Oxfam le 14 janvier 2024, « les 1 % les plus riches du monde possèdent 43 % de tous les actifs financiers mondiaux »2.
Ces dernières années, des partis et mouvements racistes et suprémacistes, satisfaits des étiquettes de « populisme de droite », sont soit arrivés au pouvoir, soit ont déterminé le pouvoir dans le monde occidental, de la Suède à la Hongrie, des États-Unis à l’Italie, de la France aux Pays-Bas.
En parallèle, les politiques impérialistes prédatrices s’intensifient, d’autant plus en période de crise multidimensionnelle aiguë du système. Ces politiques visent à s’accaparer des ressources naturelles stratégiques avec pour objectif de contrôler les chaînes de production et valeurs mondiales pour ensuite dicter les termes de la production, de la commercialisation et de l’échange. L’histoire nous enseigne que le processus d’accumulation capitaliste nécessite une politique économique et commerciale extravertie ; c’est-à-dire qu’elle doit forcément être impérialiste pour pouvoir fonctionner.
Les bombardements au Liban, le génocide en Palestine, le renversement d’un régime dictatorial en Syrie par des groupes armés soutenus principalement par les puissances régionales (Turquie, Émirats arabes unis et Israël) et atlantistes, l’accaparement à bas prix des ressources minières exploitables et des terres cultivables en Afrique par des multinationales et des États puissants, les tentatives de déstabilisation politique, l’appui aux oligarchies locales et les coups d’États en Amérique latine, l’imposition de sanctions économiques unilatérales contre les pays qui ne se plient pas au bon vouloir des maîtres impérialistes (Cuba, Venezuela, Mali, Burkina Faso, Niger, etc.), les ingérences en Haïti sous couvert d’aide humanitaire… tous ces phénomènes doivent être lus à la lumière des intérêts géostratégiques des puissances impérialistes et néocoloniales, sans oublier l’étouffement de la révolte des femmes en Iran et au Rojava. Ils se déroulent avec des massacres collectifs plus ou moins étalés dans le temps et en toute impunité, donnant un avant-goût du nouveau régime mondial de la loi du plus fort. Le bilan des catastrophes naturelles, souvent résultat de choix politiques précis et objets d’instrumentalisations politiques cyniques, est aussi très lourd.
En 2024, les droits économiques et sociaux ont régressé partout et les pays soi-disant riches ne font pas exception. Il n’y a pas de pays « riches » où les thèses racistes ou de supériorité culturelle ne déterminent pas les équilibres politiques, y compris les pays scandinaves considérés comme les plus démocratiques. En Allemagne, les Verts et le Parti social-démocrate ont prêté ardemment leur concours à la politique d’expansion de l’OTAN vers l’Est, alimentant les tensions militaires. Le Danemark, à l’instar du Royaume-Uni et l’Italie, tente de conclure des accords bilatéraux pour regrouper les réfugiés dans des camps dans les pays pauvres. L’apartheid vaccinal vécu pendant la pandémie, l’échec des sommets des systèmes alimentaires de l’ONU en 2021, de la COP 29 sur les financements pour le climat à Baku, la transformation de la Méditerranée en un cimetière pour les migrants pauvres, les guerres et les bombardements en toute impunité au Moyen-Orient ont déjà laissé des traces difficiles à effacer dans la mémoire collective des peuples et des militants pour la paix. Dans de nombreux pays, les pauvres n’ont plus la force et l’énergie d’organiser l’opposition dans la vie quotidienne.
Un Sommet de l’avenir détourné en septembre 2024
Des centaines d’organisations indépendantes de la société civile et des milliers de mouvements de base avaient peu d’attentes pour une approche systémique des problèmes de la guerre, de la crise climatique, des inégalités croissantes et du mépris du droit international lors du Sommet de l’Avenir à New York. Malgré leur réalisme, ils ont été désillusionnés de se retrouver avec un document reflétant la mainmise mondiale des multinationales exprimée dans le cadre de sustainability washing3.
Les priorités du groupe occidental (un des cinq groupes régionaux de l’ONU) et des grandes multinationales étaient triples : 1) la sécurité, signifiant la dissimulation des génocides (passés et actuels), assurer l’impunité des criminels de guerre et protéger le privilège de veto du petit groupe d’États dominant au Conseil de sécurité ; 2) la croissance économique en faveur de l’accumulation capitaliste, impliquant la marginalisation de toute tentative d’explorer en profondeur les véritables causes de l’échec des Objectifs de développement durable (ODD) , la suppression de toute une série de droits en tant que services publics, et le sabotage de tout nouveau contrat social et décolonial ; 3) occulter les questions fondamentales (justice climatique, annulation de la dette et réparations, transition écologique juste, émancipation des minorités, y compris de genres, en lien avec les structures de pouvoir suprémacistes) et entraver toute initiative visant l’autodétermination sur les ressources naturelles, la souveraineté alimentaire et la redistribution4.
La déclaration finale du Sommet de l’avenir, en dehors des choix politiques globaux imposés par les gouvernements du Nord global, contient toute une série d’engagements et de promesses. Cependant, la réalisation et l’accomplissement de ces belles paroles sont conditionnés au bon vouloir du secteur privé (autrement dit les sociétés transnationales), libéré de toute forme de régulation et de responsabilité.
Le darwinisme économique et militaire s’impose
Le darwinisme social, une théorie qui applique les principes de la sélection naturelle de Charles Darwin aux sociétés humaines, est souvent critiqué pour justifier les inégalités et la domination des plus forts. Cette idéologie semble gagner du terrain, elle s’impose comme la norme partout, fragilisant le système multilatéral qui vise à maîtriser les risques et garantir le droit de vivre en paix.
Toujours en période de crise, plus le darwinisme économique et militaire s’impose, plus le centre de la politique se recompose avec des thèses discriminatoires, racistes et antisociales. Barbara Stiegler5 rattache le néolibéralisme au darwinisme social qui s’exprime sous forme autoritaire dans le nazisme et sous forme libérale en affirmant que les plus aptes survivront.
Toujours en période de crise, plus le darwinisme économique et militaire s’impose, plus le centre de la politique se recompose avec des thèses discriminatoires, racistes et antisociales.
Les forces et les tendances néo-fascistes ou racistes (qualifiées bien souvent de populistes ou autoritaires) ne sont donc pas des adversaires antagoniques de l’oligarchie néo-libérale. Au cours de la crise sanitaire, nous avons assisté à la montée des mouvances fascistes et au renforcement des pouvoirs fascistes à travers les continents. Ces derniers ont mené une gestion sociale darwiniste de la pandémie et guerrière contre les pauvres, ainsi qu’un négationnisme de la crise climatique accompagné d’une exploitation extractiviste détruisant la nature (rivières asséchées et sites historiques déclassés en Turquie, destruction et pillage de l’Amazonie encouragés par Bolsonaro.
Plus l’échec est grand, plus la doctrine devient extrême. Les gouvernements utilisent les crises et leurs priorités sécuritaires à la fois comme prétextes et comme opportunités pour réduire les impôts pour les plus riches, privatiser les services publics restants, déchirer le filet de sécurité sociale et déréglementer les entreprises.
Le darwinisme social infecte également les droits politiques et civils et réduit davantage l’espace civique. Utilisant la situation de crise comme prétexte, les autorités de certains pays ont déployé des réponses sécuritaires sévères et des mesures d’urgence pour écraser la dissidence, criminaliser l’exercice des libertés fondamentales, faire taire les rapports indépendants et restreindre les activités des mouvements sociaux et des organisations non gouvernementales.
Utilisant la situation de crise comme prétexte, les autorités de certains pays ont déployé des réponses sécuritaires sévères et des mesures d’urgence pour écraser la dissidence, criminaliser l’exercice des libertés fondamentales, faire taire les rapports indépendants et restreindre les activités des mouvements sociaux et des organisations non gouvernementales.
La fragilisation du système multilatéral
Le système multilatéral, fondé sur des institutions comme l’ONU, vise à promouvoir la coopération internationale et à résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Cependant, l’émergence du darwinisme social et militaire dans les politiques nationales et internationales menace ce système.
Les États adoptent de plus en plus des budgets de guerre, privilégiant leurs intérêts géostratégiques au détriment de la coopération internationale.
La paix, autrefois considérée comme une valeur universelle, semble perdre de son importance. Les conflits armés et les tensions géopolitiques augmentent, souvent justifiés par des discours de sécurité nationale et de protection des intérêts économiques. Cette militarisation des relations internationales renforce les rapports de domination et l’accumulation de ressources au détriment de la justice sociale et de modèles de développement équitables.
Cette militarisation des relations internationales renforce les rapports de domination et l’accumulation de ressources au détriment de la justice sociale et de modèles de développement équitables.
Quand la violence militaire devient un outil pour préserver les rapports de domination, les grandes puissances utilisent leur force militaire pour maintenir leur influence et contrôler les ressources stratégiques. Cette dynamique entraîne le maldéveloppement, où les ressources sont détournées des besoins humains pour financer des armements et des conflits.
Face à cette situation extrêmement alarmante et urgente, l’objectif principal des mouvements sociaux devrait être de promouvoir un système multilatéral des peuples. En ce sens, ils doivent s’engager pour :
- le renforcement de l’ONU. Cela signifie investir dans l’ONU pour renforcer ses capacités à promouvoir la paix et la coopération internationale ;
- la promotion de la diplomatie afin d’encourager les États à privilégier les canaux diplomatiques et les solutions pacifiques aux conflits ;
- l’investissement dans l’information et l’éducation qui impliquent la mise en place de programmes éducatifs pour sensibiliser les populations aux dangers du darwinisme social et aux avantages de la coopération internationale ;
- la réduction des dépenses militaires et le désarmement afin de réorienter les dépenses militaires vers des investissements dans le développement équitable et les besoins humains.
Encadré
Virilisme et darwinisme social : deux soutiens idéologiques à la loi du plus fort
La mentalité viriliste de l’idéologie dominante, plus particulièrement coloniale, joue un rôle crucial dans l’exacerbation des souffrances des femmes pendant les conflits. Les idéologies virilistes valorisent la force, l’agressivité et la domination, ce qui peut normaliser les violences contre les femmes. Cette violence est souvent justifiée ou tolérée dans des cultures où la masculinité est définie par la domination et la force. Les idéologies virilistes tendent à exclure les femmes des rôles dirigeants et des processus de prise de décision. Cela signifie que les besoins et les perspectives des femmes sont souvent ignorés dans les négociations de paix et les efforts de reconstruction, perpétuant ainsi leur marginalisation.
L’absence de femmes indépendantes et progressistes dans les positions de pouvoir peut entraîner des politiques et des pratiques qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques de toute une population. De surcroît, les idéologies virilistes renforcent souvent les stéréotypes de genre traditionnels, où les femmes sont vues principalement comme des mères, des épouses et des soignantes. Ces rôles peuvent limiter leur accès aux ressources et aux opportunités, les rendant plus vulnérables en temps de conflit.
Dans le cadre de l’économie de guerre, le travail des femmes, bien souvent non rémunéré et centré sur le soin, est dévalorisé. Cela peut entraîner une reconnaissance moindre de leurs contributions et une protection moindre de leurs droits. Tant de la part des classes dirigeantes néo-coloniales que dans les sociétés où le patriarcat est prédominant, la violence contre les femmes peut être tolérée ou minimisée. Cela peut conduire à une impunité pour les auteurs de violences, perpétuant ainsi un cycle de violence, ce qui implique aussi une difficulté pour les femmes d’obtenir justice pour les violences subies. Les idéologies virilistes peuvent justifier le contrôle des corps des femmes et celui des filles, y compris leur sexualité et leur reproduction au service de la politique militaire. Les femmes peuvent être réprimées pour avoir revendiqué leurs droits ou pour avoir défié les normes de genre traditionnelles.
Le darwinisme social et l’idéologie viriliste vont de pair
Le darwinisme social et l’idéologie viriliste sont compatibles à plusieurs niveaux, quel que soit le sexe des dirigeant.e.s qui les promeuvent, notamment en ce qui concerne leur vision de la hiérarchie des cultures, de la compétition néo-libérale et de la domination coloniale. Voici quelques éléments d’analyse qui expliquent pourquoi ces deux idéologies se renforcent mutuellement.
Hiérarchie et domination
- Darwinisme social : Cette idéologie prône la survie du plus fort et justifie les inégalités sociales et économiques comme étant le résultat naturel de la compétition. Elle soutient que les plus forts et les plus aptes doivent dominer les plus faibles.
- Idéologie viriliste : Cette idéologie valorise la force, l’agressivité et la domination comme des traits masculins idéaux. Elle encourage les hommes à exercer leur pouvoir et leur contrôle sur les autres, en particulier sur les femmes et les populations colonisées.
Compétition et conflit
- Darwinisme social : Il voit la compétition comme un moteur naturel et nécessaire du progrès. Les conflits et les luttes pour les ressources sont considérés comme inévitables et même bénéfiques pour l’évolution de la société.
- Idéologie viriliste : Elle valorise la compétition et le conflit comme des moyens pour les hommes de prouver leur virilité et leur supériorité. Les conflits sont souvent vus comme des opportunités pour les hommes de démontrer leur force et leur courage.
Exclusion et marginalisation
- Darwinisme social : Il peut justifier l’exclusion et la marginalisation des groupes considérés comme moins aptes ou moins forts. Cela peut inclure les femmes, les minorités ethniques ou d’autres groupes vulnérables.
- Idéologie viriliste : Elle peut également justifier l’exclusion des femmes des rôles de pouvoir et de décision, en les reléguant à des rôles subordonnés et en les considérant comme moins capables ou moins importantes.
Justification de la violence raciste et sexiste
- Darwinisme social : Il peut justifier la violence comme un moyen naturel de résoudre les conflits et d’assurer la survie des plus forts. La violence est vue comme une partie inévitable de la lutte pour l’existence.
- Idéologie viriliste : Elle peut justifier la violence contre les femmes et d’autres groupes vulnérables comme un moyen pour les hommes de démontrer leur domination et leur supériorité.
Renforcement des stéréotypes de genre
- Darwinisme social : Il peut renforcer les stéréotypes de genre en justifiant les rôles traditionnels des hommes et des femmes comme étant naturels et immuables. Les hommes sont vus comme des chasseurs et des protecteurs, tandis que les femmes sont vues comme des soignantes et des reproductrices.
- Idéologie viriliste : Elle renforce également ces stéréotypes en valorisant les traits masculins de force et de domination, et en dévalorisant les traits féminins de soin et de coopération.
Impunité et injustice
- Darwinisme Social : Il peut justifier l’impunité pour les plus forts et les plus puissants, en considérant que leur domination est naturelle et méritée.
- Idéologie viriliste : Elle peut également justifier l’impunité pour les hommes qui exercent leur domination sur les femmes, en considérant que leur comportement est naturel et justifié.
En résumé, le darwinisme social et l’idéologie viriliste sont compatibles parce qu’ils partagent une vision du monde basée sur la hiérarchie, la compétition et la domination. Ils justifient tous deux les inégalités et les violences comme étant naturelles et inévitables ; ils renforcent les stéréotypes de genre qui marginalisent et excluent les femmes des processus de décision ; ils tolèrent l’impunité et justifient le contrôle et la répression des femmes. Pour la paix, la justice sociale et une véritable égalité, nous devons combattre ces idéologies et les structures de pouvoir qui les soutiennent.
________________________________________________________________________________________________________________
NOTES
1Théorie qui applique les principes de la sélection naturelle de Charles Darwin aux sociétés humaines.
2Cf. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report%20-%20French_0.pdf
3Le terme « sustainability washing » fait référence à une pratique lorsque des entreprises ou des organisations exagèrent, faussent ou communiquent de manière trompeuse leurs efforts en matière de développement durable ou de durabilité environnementale, appelée « greenwashing ».
4Pour de plus amples informations à ce propos, prière de se référer à la déclaration écrite du CETIM, présentée à la 57e session du Conseil des droits de l’homme, A/HRC/57/NGO/201, diffusé le 13 septembre 2024, https://www.cetim.ch/le-sommet-de-lavenir-de-lonu-et-le-droit-au-developpement/
5Voir https://www.liberation.fr/debats/2019/12/20/barbara-stiegler-pour-le-neoliberalisme-l-idee-que-l-on-puisse-se-retirer-est-un-archaisme_1770504/