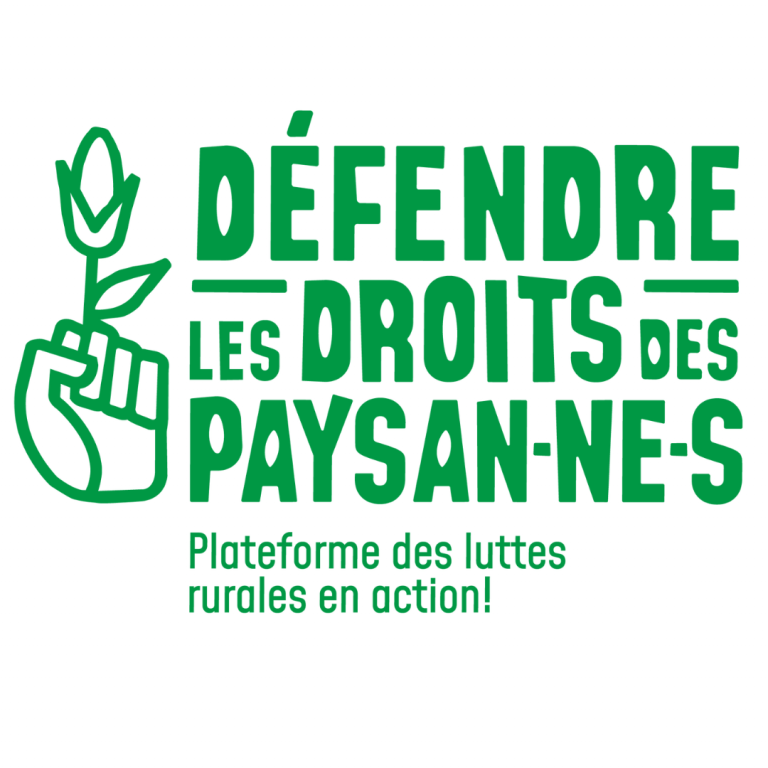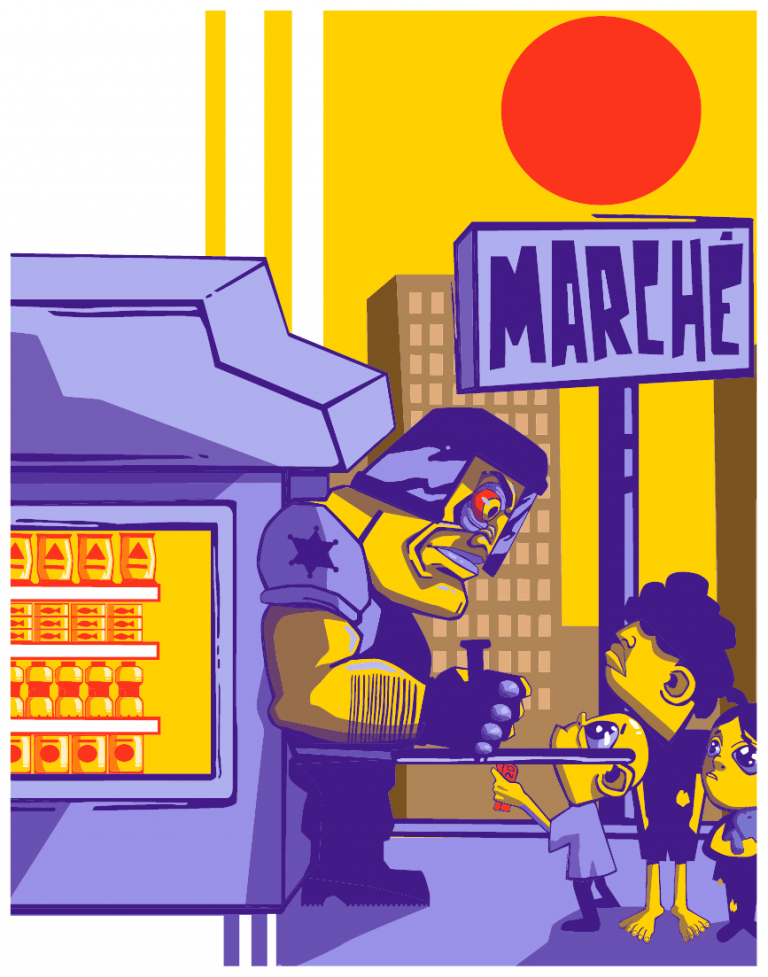Édito

Ces dernières années, nous assistons à l’intensification des conflits armés pour résoudre les différends entre les États qui font fi du droit international, ainsi qu’à la militarisation croissante des sociétés.
L’augmentation vertigineuse des dépenses en armement augure de guerres de plus en plus meurtrières et destructrices : en 2023, 2’443 milliards de dollars ont été dépensés à l’échelle mondiale, dont 1’341 par les États membres de l’OTAN (916 par les États-Unis), suivis de la Chine (296), de la Russie (109), de l’Ukraine (64,8) et du Japon (50,2)1.
La militarisation des sociétés est extrêmement préoccupante à plusieurs titres : l’entraînement dans des guerres destructrices qui à leur tour ont comme conséquences des violations massives des droits humains, en particulier le droit à l’autodétermination des peuples ; l’orientation des ressources vers les dépenses en armement au détriment des services publics (éducation, santé, logement, énergie…) accentuent les inégalités, tout en provoquant de nouveaux conflits encore plus graves ; menaces sur la démocratie et le vivre ensemble, comme en témoigne la montée des mouvements politiques réactionnaires, voire même fascisants.
Certes, les conflits armés sont la conséquence de crises multiples : économique, sociale, politique, environnementale… Ils sont aussi provoqués par les puissants de ce monde pour la domination, pour le contrôle des ressources naturelles, pour décider les termes de l’échange (commercial et financier notamment), etc. De nos jours, il n’est plus impossible que les confrontations entre les puissances débouchent sur une guerre nucléaire.
Pour le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, « l’état dans lequel se trouve notre monde n’est pas viable. »2 Il déplore en particulier « un monde d’impunité dans lequel les violations et les atteintes menacent le fondement même du droit international et de la Charte des Nations Unies. »3
En effet, la guerre est de plus en plus utilisée comme un outil géopolitique de domination, d’asservissement des peuples, un moyen lucratif pour certains et pour faire taire toute voix dissonante au nom de la « sécurité nationale » ou des « intérêts supérieurs de l’État ».
Dans ce contexte, est-ce que le darwinisme social est en passe de devenir la norme ? La course aux armements ne viole-t-elle pas les normes patiemment élaborées au sein de l’ONU pour garantir la paix et procéder au désarmement ? Pourquoi le système multilatéral, représenté par l’ONU, est-il attaqué, ou ignoré, c’est selon, par les puissants ? Quelles sont les menaces que font peser les guerres sur nos sociétés au-delà des destructions indicibles ? Que peuvent faire les mouvements pour la paix, bien souvent réprimés et criminalisés par les pouvoirs va-t-en guerre ? Le numéro 5 de la revue Lendemains solidaires tente d’apporter un éclairage à ces questions avec différents points de vue.
________________________________________________________________________________________________________________
NOTES
1Cf. Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity, publié le 22 avril 2024 sur le site du Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/media/press-release/2024/global-military-spending-surges-amid-war-rising-tensions-and-insecurity
2 Déclaration faite à l’occasion de l’ouverture de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre dernier, https://press.un.org/fr/2024/sgsm22378.doc.htm
3Idem.